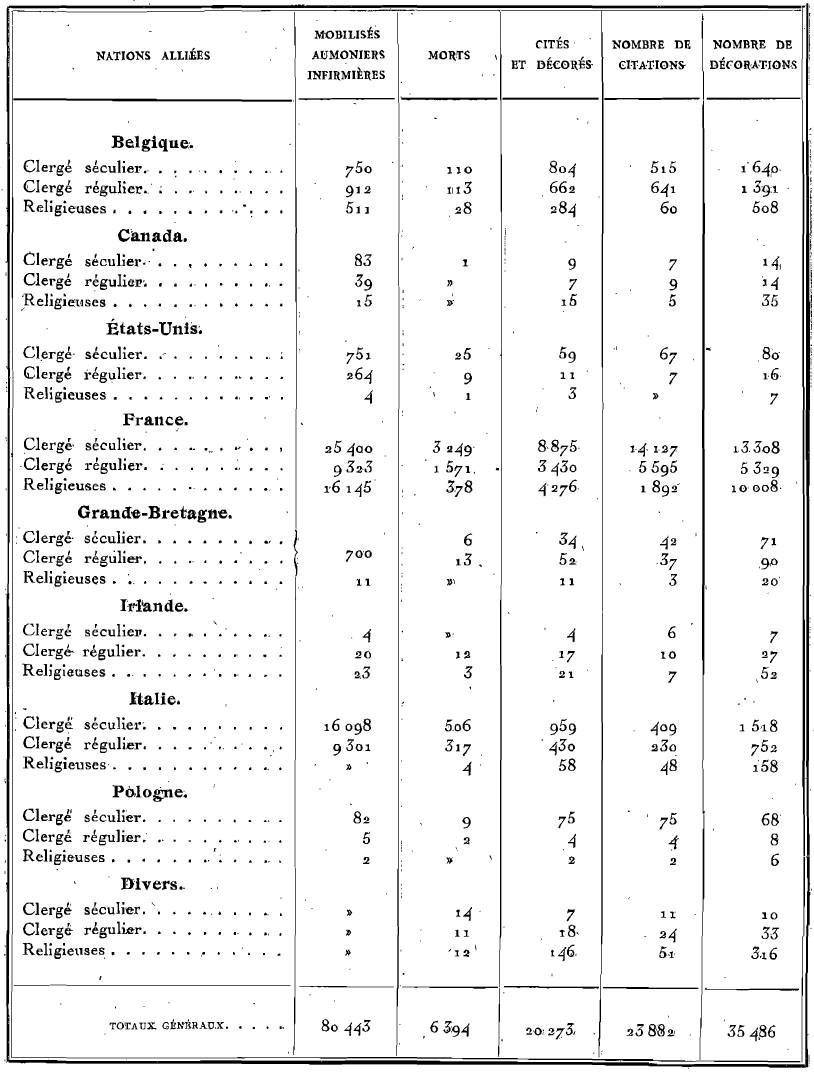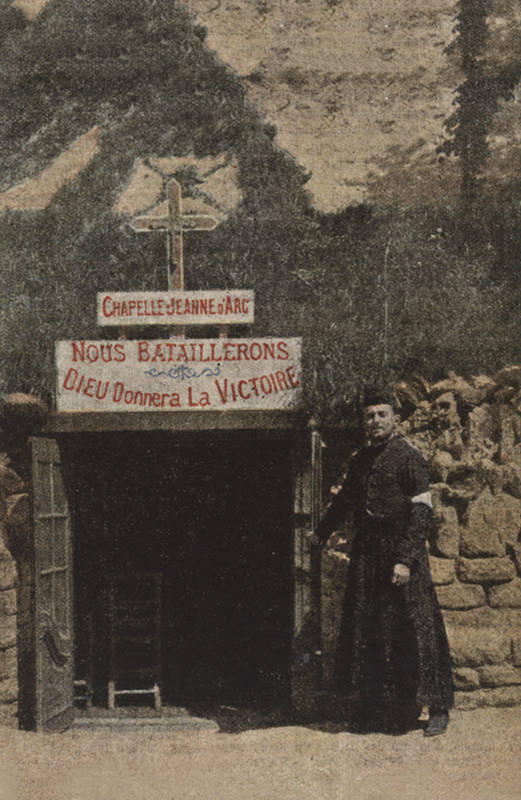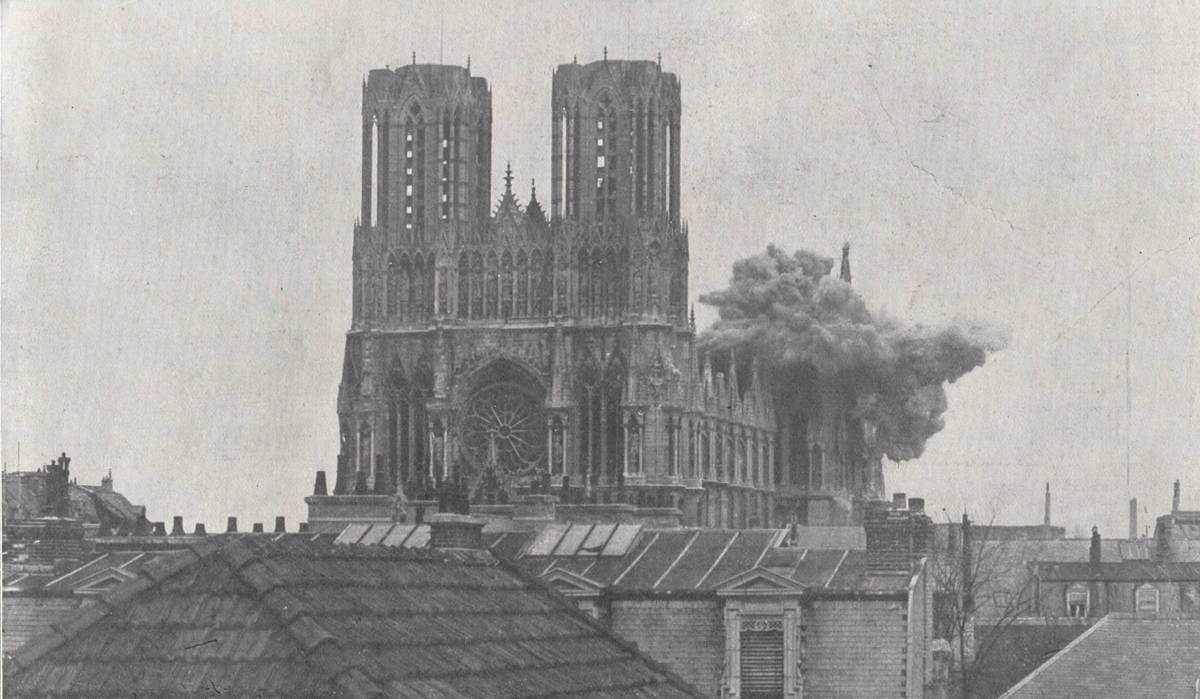Les religieux:
Le 2 août 1914, alors que les troupes allemandes avaient
déjà envahi le Luxembourg, le président de la
république française adressait un message solennel aux
assemblées: "Dans la guerre
qui s'engage, le France a pour elle le droit, dont les peuples, non
plus que les individus, ne sauraient impunément
méconnaître l'éternelle puissance morale. Elle sera
héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien
ne brisera devant l'ennemi l'Union sacrée et qui sont
aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même
indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique".
Bien que particulièrement persécutés avant la
guerre, les religieux entendront cet appel. Les prètres et les
religieux dont les congrégations avaient été
autorisées ont été mobilisés comme les
autres français (loi du 15 juillet 1889 dit des Curés sac
au dos) et ont souvent été affectés dans des
unités combattantes. Les religieux qui avaient dû fuir
à l'étranger revinrent massivement, mais purent plus
facilement négocier des postes plus en accord avec leur
sacerdoce: aumôniers, brancardiers, infirmiers, ce qui ne veut
pas dire planqués. Sur 37000 religieux incorporés, 5000
sont morts pour la France.
La messe prés du front

Aumôniers des trois confessions:

Les religieuses:
À l'entrée en guerre la France manquait cruellement
d'infirmières civiles. En 1864 est bien créée dans
la foulée de la création de la croix rouge internationale
une Société de Secours aux Blessés Militaires
(SSBM), bientôt scindée avec une Association de Dames
Françaises (ADF) de sensibilité protestante et une Union
des Femmes Françaises (UFF) de sensibilité laïque.
Si ces mouvances délivraient un enseignement sanitaire de
qualité, les effectifs atteints n'étaient en aucun cas
suffisants. En 1902 Emile Combes essaie bien de créer une
école d'infirmières par département, mais le
projet tourne court faute de moyens. Les lois Combes expulsent
néanmoins les religieuses des hôpitaux publiques. C'est
finalement à la Pitié-Sapétrière que
naît en 1907 la première école d'infirmière
publique, suivie peu aprés par celles d'autres hôpitaux de
la région parisienne. Les effectifs formés sont là
aussi trés nettement insuffisant face aux centaines de milliers
de blessés français qui vont bientôt affluer dans
les hôpitaux militaires.
C'est à ce moment que les religieuses vont
massivement se mettre à la disposition des forces armées.
Plus de 16000 d'entre elles vont servir dans les services hospitaliers
du front (où l'on rencontrait souvent des prètres
infirmiers) et surtout dans les hôpitaux et infirmeries
de l'arrière. Toutefois l'uniforme ne les
différenciait guère de leur collègues civiles, ce
qui a facilité le déni ultérieur de leur
précieuse aide.
Une sœur de la charité exerçant comme infirmière:



La rumeur infâme:
Pendant la guerre, les religieux furent d'un grand secours et furent
trés bien vus des combattants, ce qui pouvait déplaire
aux anticléricaux acharnés qui n'avaient jamais
désarmés. Quelques rumeurs infâmes coururent ainsi
pendant la guerre, dont les archétypes étaient les
suivants:
- Ce sont les curés qui ont voulu la guerre
- Les prêtres envoient de l'argent aux prussiens pour prolonger la guerre
- Au moins les curés veulent ils la guerre
puisqu'ils ont amassé de l'or qu'ils ont porté
à la Banque de France pour la continuer
- Les curés militaires sont des embusqués
- Benoît XV est un germanophile, car il veut une paix favorable aux allemands
Cela donna lieu à de violentes controverses au cours de la grande guerre et même aprés.
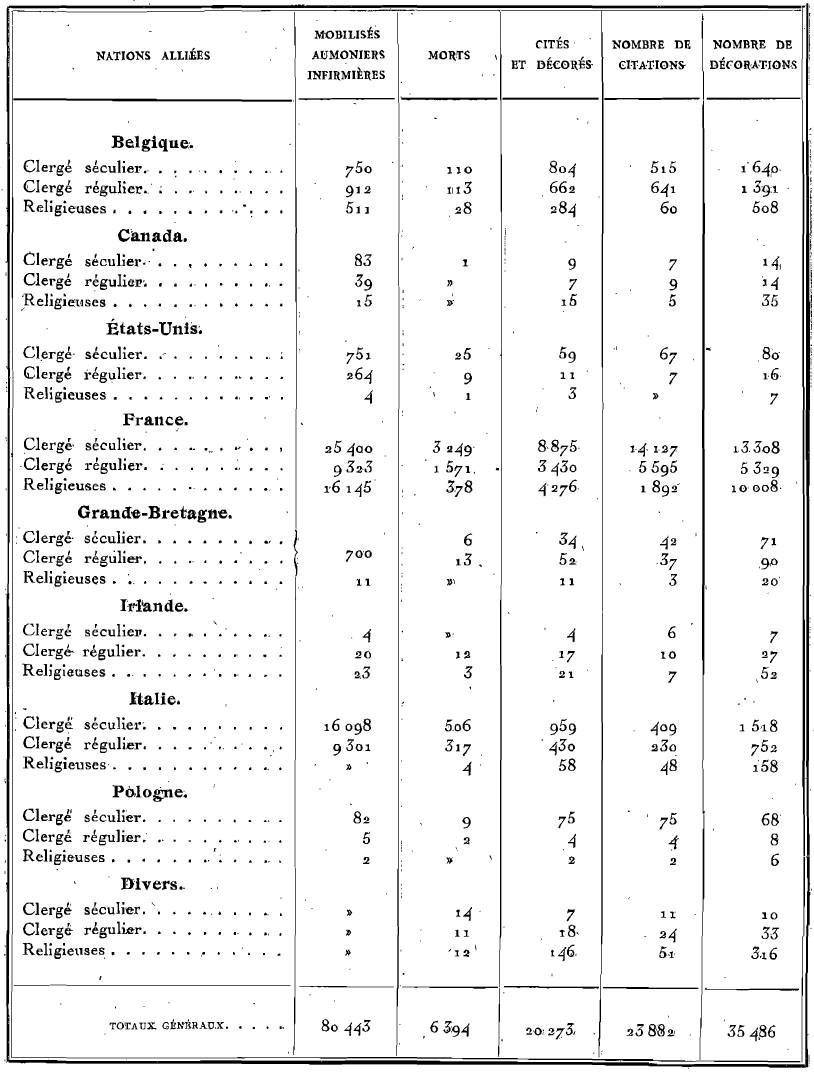
Une chapelle souterraine prés du front - région de Reims:
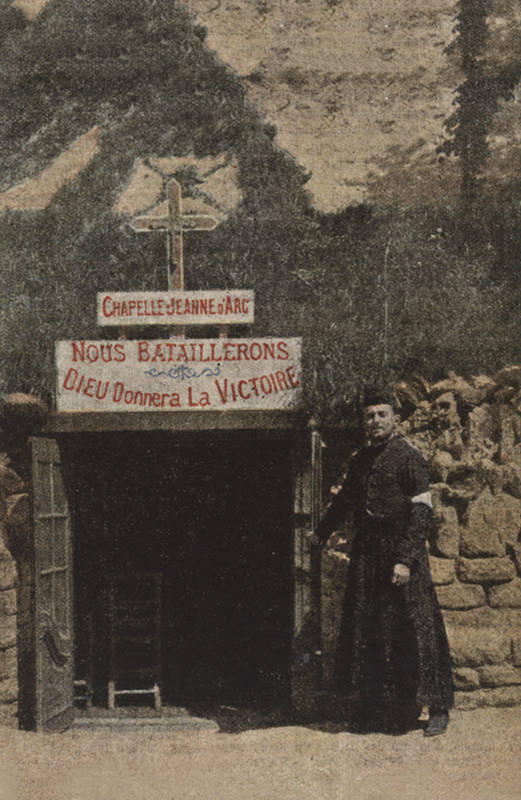
La
cathédrale de Reims:
Reims a commencé à être
bombardée en
septembe 1914, et le fut régulièrement jusqu'en
1918. En
France, la destruction de la cathédrale, dont il fut
décidé de tout sauver et de tout restaurer,
devint le
symbole de la barbarie allemande (selon les termes de
l'époque: pirates boches, vandales, barbares).
La cathédrale touchée par un obus le 19 avril 1917 vers une heure de l'aprés midi:
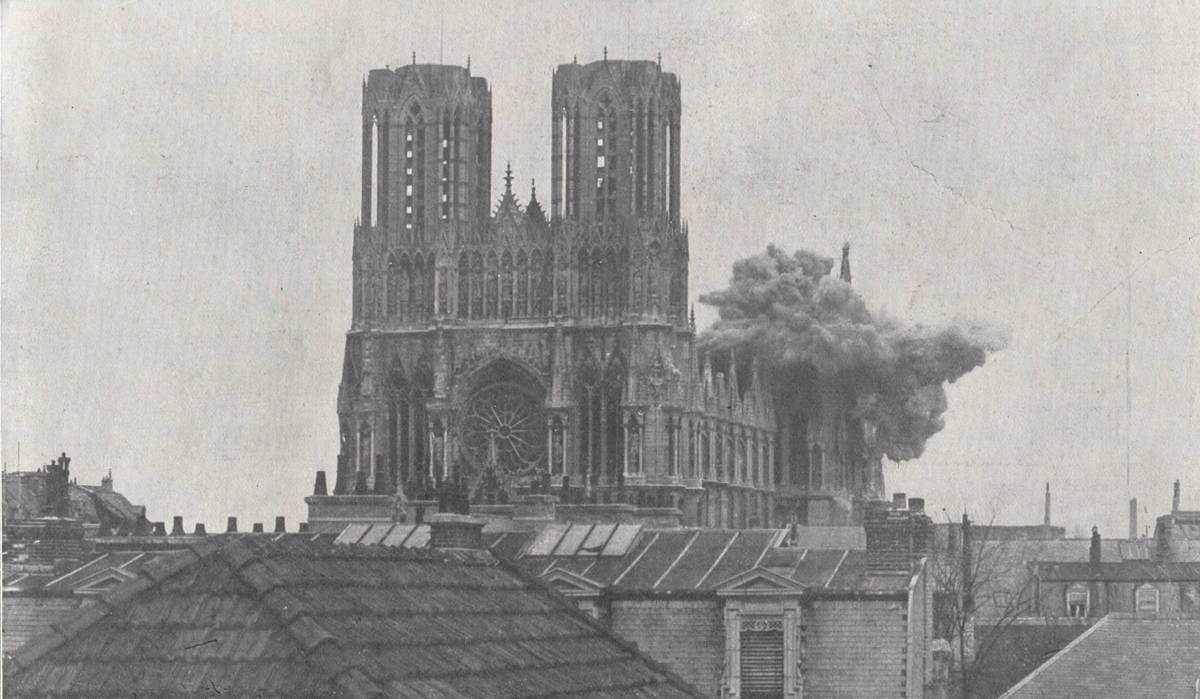
Vue du ciel aprés les bombardements:

La cathédrale d'Amiens: les portails ont été protégés par des sacs de terre

Cathédrale de Soissons - un contrefort a été détruit par l'artillerie allemande

Le pape Benoit XV:
Son attitude de neutralité a offensé beaucoup de croyants
dans les différents pays en guerre. Il condamna ainsi aussi bien
le torpillage du Lusitania que le blocus de l'Allemagne. Il fit une
ouverture de paix en 1917 qui échoua